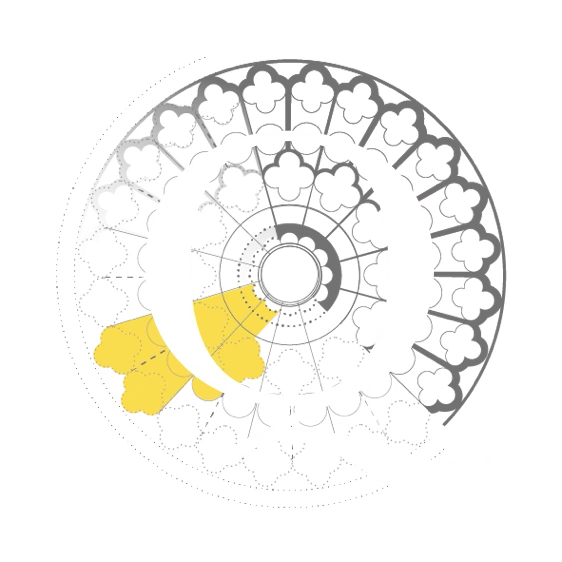 quasi.modo
quasi.modo
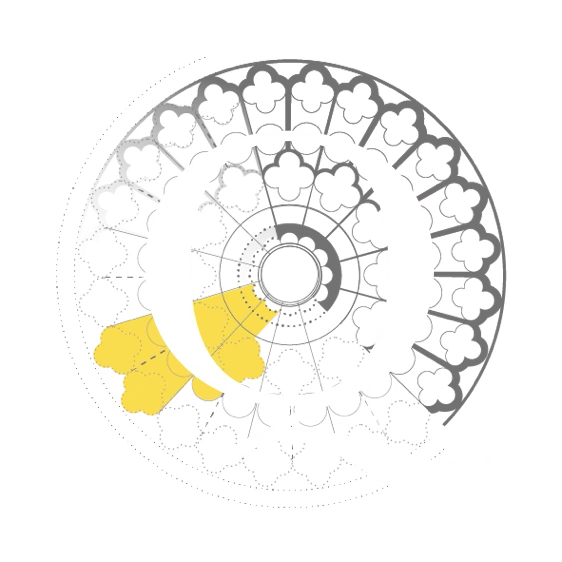 quasi.modo
quasi.modo
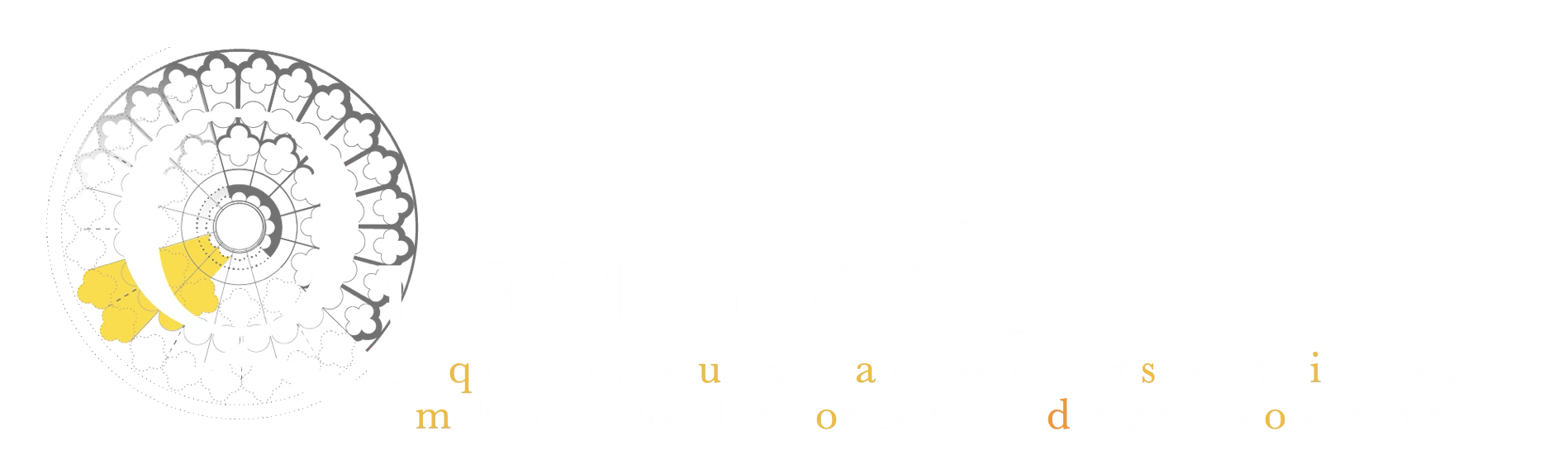
Quasi.modo est une architecture conceptuelle et technique dédiée à l'exploration, l'intégration et l'interopérabilité des données et des connaissances produites autour d'objets patrimoniaux complexes. Son nom est un acronyme de "Querying and Unifying Architecture for Semantic Integration of Multidimensional Orchestrated Disciplinary Observations", exprimant à la fois sa fonction — interroger, unifier et structurer — et son ambition : articuler des observations disciplinaires multiples dans une logique de convergence sémantique.
Le point séparant Quasi et modo est intentionnel : il marque une articulation critique. Il symbolise à la fois un connecteur fonctionnel et une modularité intellectuelle entre une approche ouverte, évolutive (quasi, "presque", "en formation") et une structure méthodique (modo, "manière", "mode"). Cette ponctuation reflète la nature du projet : un espace interstitiel —ni rigide ni strictement normatif— mais orchestré pour permettre la coexistence raisonnée de logiques disciplinaires parfois hétérogènes.
La référence implicite à Quasimodo, le personnage emblématique du roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris, fait référence au personnage marginal et central, physiquement déformé mais profondément humain, gardien de la cathédrale et témoin silencieux de son histoire. Il incarne une forme de connaissance sensible, située au-dessus, entre le visible et l'invisible. De même, quasi.modo aspire à être un gardien numérique des données scientifiques liées à Notre-Dame et à d'autres sites patrimoniaux, capable d'embrasser la complexité de leur documentation multidisciplinaire tout en préservant la singularité de chaque regard savant.
Enraciné dans le travail scientifique mené autour de la restauration de Notre-Dame de Paris, le projet quasi.modo cherche à permettre une intégration sémantique n-dimensionnelle —spatiale, temporelle, morphologique, lexicale et méthodologique. Il offre un cadre unifié mais flexible, où les données de numérisation 3D, annotations, archives, analyses scientifiques et récits peuvent être explorées, liées et interrogées en utilisant des protocoles de recherche rigoureux, documentés et adaptables.
Quasi.modo n'est ni juste un acronyme ni simplement une plateforme logicielle. C'est un système de médiation des connaissances, un pont entre les disciplines, un observatoire augmenté des pratiques scientifiques et professionnelles — faisant écho au personnage dont il évoque le nom, et au monument dont il hérite la mémoire.
Explorez des ensembles d'annotations géolocalisées sur des modèles 3D patrimoniaux. Chaque collection vous permet de naviguer dans un environnement 3D interactif, de découvrir des annotations expertes avec leurs métadonnées, et d'analyser les relations sémantiques entre les éléments documentés.
Chargement des collections publiques...
Découvrez des récits spatialisés qui combinent narration et exploration 3D. Ces mnémogrammes vous guident à travers des parcours thématiques dans l'espace patrimonial, révélant les liens entre lieux, objets et histoires grâce à des annotations contextuelles et des transitions fluides entre les points d'intérêt.
Chargement des récits patrimoniaux...
L'ampleur de notre patrimoine numérique collaboratif en quelques données
Connectez-vous pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités ou créez votre compte
quasi.modo est développé dans le cadre du projet de recherche européen n-Dame_Heritage (2022-2027), financé par une bourse ERC Advanced Grant du Conseil européen de la recherche.
Le projet n-Dame_Heritage vise à créer un écosystème d'analyse et de mémorisation n-dimensionnel pour construire des cathédrales de connaissances en sciences du patrimoine, en s'appuyant sur l'étude de Notre-Dame de Paris.
Le projet n-Dame_Heritage est dirigé par Livio De Luca (Directeur de Recherche CNRS-MAP UMR 3495), investigateur principal et coordinateur du projet. L'équipe de recherche comprend Anthony Pamart et Adeline Manuel pour la modélisation conceptuelle et la numérisation sémantiquement enrichie multi-échelle et multi-temporelle, Anais Guillem et Kevin Réby pour la formalisation des connaissances et l'apprentissage automatique, ainsi que Violette Abergel et Emile Blettery pour la corrélation et visualisation de données n-dimensionnelles.
Le projet forme également une nouvelle génération de chercheurs avec les doctorants Antoine Gros (CNRS-MAP / LMGC / LISPEN), Laura Willot (CNRS-MAP / ETIS / LASTIG), et Melvin Hersent (CNRS-MAP / LASTIG / LISPEN).
La production et curation du corpus de données, essentielle pour expérimenter l'intégration, l'analyse et la corrélation des données, est assurée par Cristina Dagalita (CNRS-MAP / INHA), Pierre Arese, Salomé Gallician (CNRS-MAP / INP), Florent Comte et Roxane Roussel (CNRS-MAP).
Le développement de la plateforme numérique, conçue pour centraliser, enrichir et spatialiser les données hétérogènes, mobilise Miled Rousset (CNRS-MOM), Sara Tournon (CNRS-Archevision), Violette Abergel, Adeline Manuel, Anthony Eberlin, Mathieu Salel et Arthur Mondo (CNRS-MAP).
Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'action scientifique Notre-Dame de Paris CNRS/MC (2019-2024), coordonnée par Livio De Luca, qui rassemble de nombreux laboratoires : CNRS-MAP, Archeovision, CITERES, ETIS, LaSTIG, LRMH, LS2N, MIS, MOM, ainsi que des groupes de travail thématiques sur la pierre, le bois, le métal, les vitraux, la structure, l'acoustique, les émotions patrimoniales et les décors.